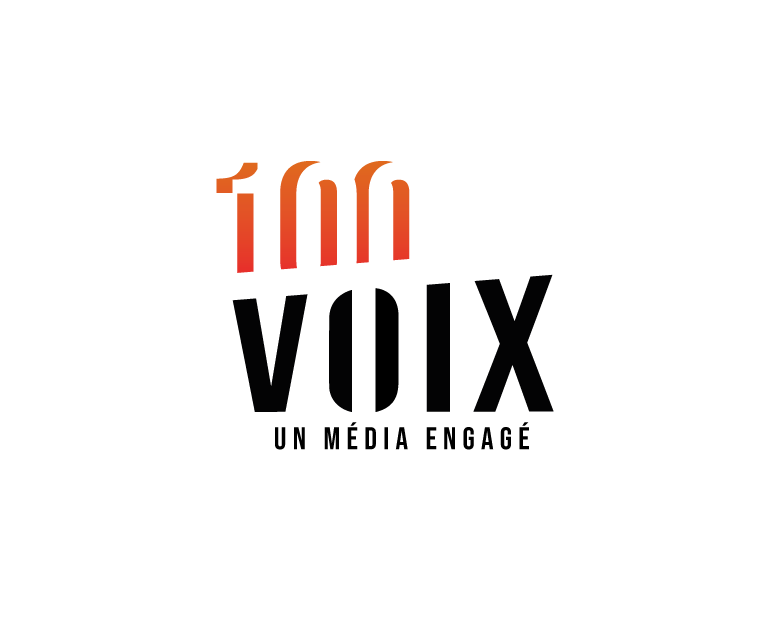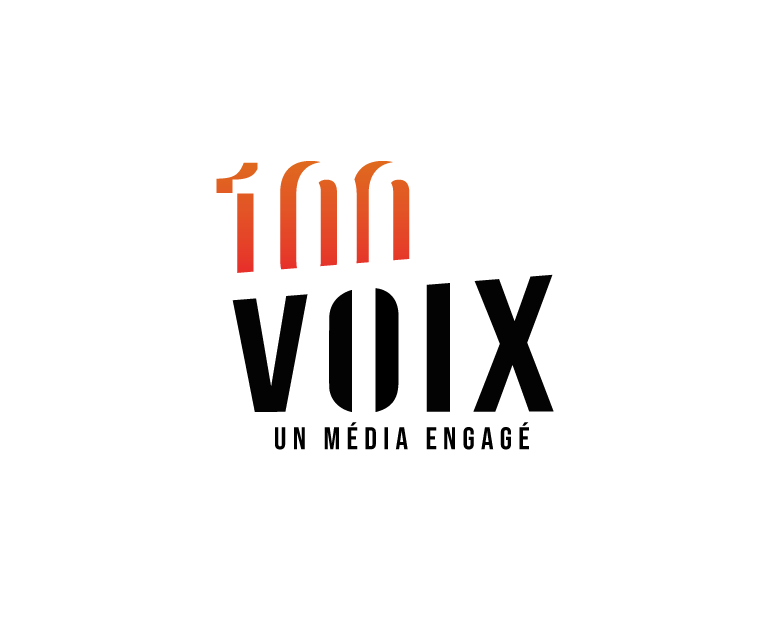NewVo fait le portrait : Nicolas Cadène, rapporteur général de l’Observatoire de la Laïcité
1- Pouvez-vous présenter ?
Je m’appelle Nicolas Cadène, je suis un Nîmois de 34 ans, et actuellement le rapporteur général de l’Observatoire de la laïcité. En parallèle, je reste un militant engagé au niveau associatif et politique.
2- D’où vient votre sens de l’engagement ?
Sans doute à la fois de mon histoire personnelle, familiale, et de mon expérience associative. Mes grands-parents comme mes parents m’ont largement appris le sens du collectif, ce que signifiait l’éthique, la solidarité ou encore l’engagement pour la cause publique.
Très tôt, je me suis investi dans la vie associative, à travers des mouvements comme, notamment, Amnesty International, la Ligue des droits de l’Homme, Médecins du Monde ou la Croix rouge dont j’ai été secouriste quelques années. Je me suis également investi dans le Samu social au début des années 2000 puis ensuite au sein du Parti socialiste.
3- C’est quoi l’Observatoire de la Laïcité ? Quels sont ses buts ?
C’est une instance pluraliste installée en 2013 par le Président de la République, composée de 23 personnes et présidée par Jean-Louis Bianco. Elle est rattachée administrativement au Premier ministre mais est tout à fait indépendante dans ses travaux internes.
Nous avons pour mission de conseiller le Gouvernement dans son action visant au respect du principe de laïcité. Pour cela, nous réalisons notamment des états des lieux annuels, très précis, sur l’application du principe de laïcité dans tous les secteurs concernés et sur tous les territoires.
Nous pouvons aussi nous autosaisir ou être saisis par le Gouvernement ou par les tribunaux sur tout sujet qui concerne la laïcité ou la gestion du fait religieux. Plus largement, nous formons et aidons à former des acteurs de terrain partout en France.
4- Pourquoi le combat laïque n’est pas un combat comme les autres ?
Parce que par définition il n’est pas et ne doit pas être partisan. Il porte même une certaine universalité. Le combat laïque, c’est celui de la liberté absolue de conscience, c’est celui de la liberté d’avoir des convictions et de les manifester dès lors qu’on ne trouble pas l’ordre public. C’est-à-dire dès lors qu’on ne s’oppose pas aux libertés d’autrui, à l’intérêt du collectif.
La laïcité, c’est la clé de la construction de la citoyenneté qui fait de chacune et de chacun d’entre nous, au-delà de nos appartenances propres, des citoyennes et des citoyens à égalité de droits et de devoirs. C’est ce qui nous permet d’aller au-delà de nos différences, de les dépasser tout en les respectant et, même, en en faisant une richesse. C’est donc un cadre commun à nous tous, quelles que soient nos convictions.
C’est pourquoi il n’est pas acceptable de l’instrumentaliser à des fins partisanes. On ne « joue » pas avec la laïcité.
5- La laïcité pour les Nuls, pourquoi ce livre maintenant ?
Parce qu’on constate des difficultés à définir la laïcité et à la pratiquer concrètement. Aujourd’hui, on parle de laïcité à longueur d’ondes, elle couvre les kiosques à journaux, on la met à toutes les sauces. Or, mal connue ou instrumentalisée, la laïcité devient un prétexte commode pour parler d’autre chose.
Durant trop longtemps, on a collectivement cru que la laïcité était une évidence pour tous. En réalité, en abandonnant ce travail de pédagogie et d’explicitation de la laïcité sur le terrain, on a laissé le champ libre à cette instrumentalisation.
D’outil de rassemblement, il est devenu pour certains un outil de stigmatisation ou d’exclusion. Il faut sortir des discours et être concret tout en évitant les surenchères.
Il faut donc garder la tête froide et apporter des réponses aux problèmes sur le terrain. C’est ce que fait ce livre.
Il rappelle aussi que pour garantir l’effectivité de la laïcité, il ne faut pas négliger la question sociale. Jean Jaurès disait en 1904, à une époque où la situation était bien plus tendue qu’aujourd’hui : « La République doit être laïque et sociale. Elle restera laïque si elle sait rester sociale ».