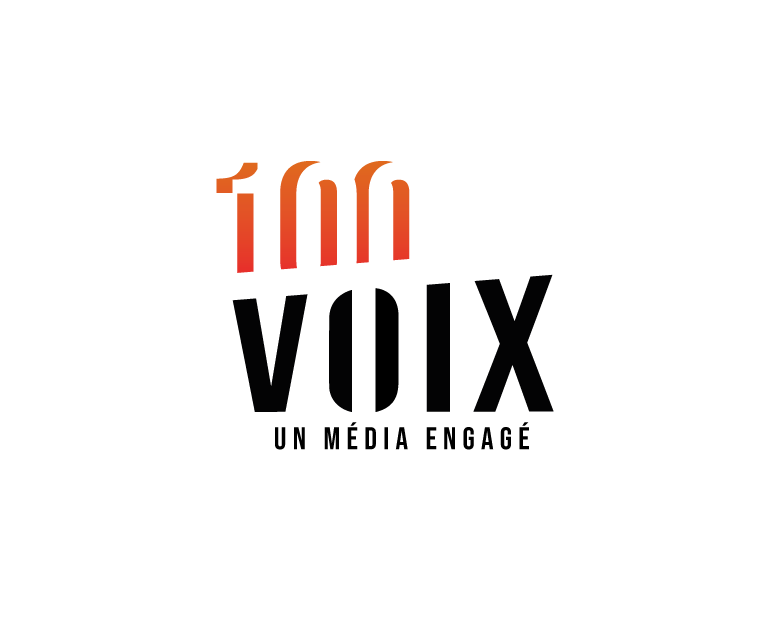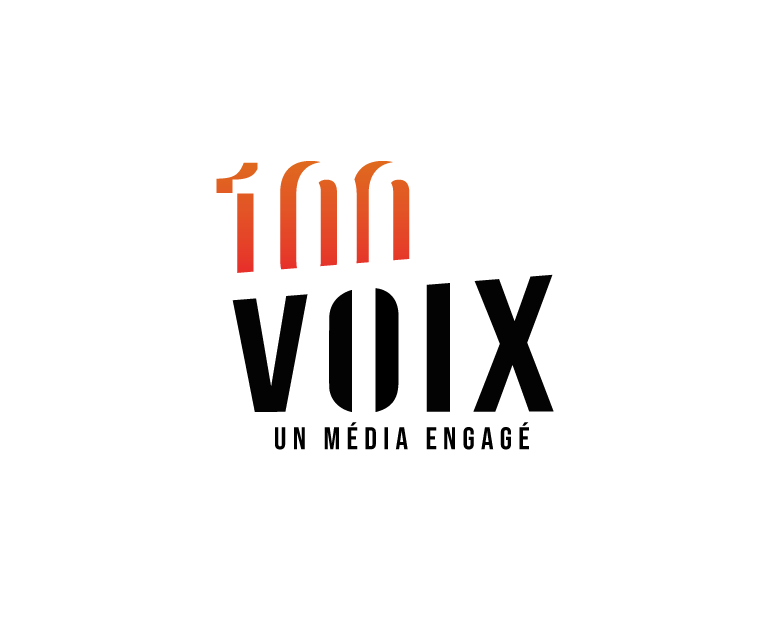Véritables produits de consommation capitalisés, nos attentions se trouvent au cœur d’un système axé sur la concentration de capitaux. Ce consumérisme attentionnel s’impose au cours des années 1990 alors que le véritable enjeu capitaliste ne se trouve plus tant du côté de la consommation, que de l’attention qu’elle nécessite. Ainsi monnayable, l’attention tend à caractériser le « temps de cerveau disponible » d’un consommateur passif. En outre, « si TF1 nous offre gratuitement des émissions télévisées, c’est parce que le produit, c’est notre attention. »[1]A cela s’ajoute une omniprésence médiatique qui canalise et conditionne notre attention. Ainsi sur-sollicités et saturés, sommes-nous pour autant condamnés à une dissipation capitalisée par une économie oligarchique de l’attention ? A rebours d’un fatalisme de la standardisation capitalisable nourrit par un déterminisme technologique, les commissaires de l’exposition des attentions se veulent garants d’une Ecologie de l’attention formulée par Yves Citton en 2014.
Invités à célébrer les dix ans du projet curatorial numérique Royal Garden, Brice Domingues, Catherine Guiral et Hélène Meisel investissent ainsi le site internet et les murs du Crédac d’une thématique ambitieuse et éminemment actuelle. Créées au tournant des années 1990, les œuvres collectées par les commissaires articulent la problématique attentionnelle tandis que le corpus qu’elles composent s’émancipe et organise différents niveaux de lecture. L’ambition explicitement énoncée dans le communiqué de presse est d’explorer la « duplicité [et la qualité] des régimes d’attention dans un milieu numérique » ainsi que d’interroger l’émergence d’une économie de l’attention et ses conséquences sur la perception.

À l’évidence, l’intitulé de l’exposition cristallise l’ambition des commissaires ; à savoir, une polyphonie attentionnelle. Mais comment exposer l’ « envoutement médiatique » en évitant la banalité du constat ainsi que le topos d’une lamentation générale dénuée d’espoir ? Il semble que le commissariat d’exposition se soit dignement saisit de cet écueil.
En disposant à notre vue des œuvres lucides face aux dynamiques actuelles, les commissaires dénoncent les enjeux de l’envoûtement médiatique de manière à les soumettre à notre jugement, tout en nous y exposant – c’est-a-dire en nous soumettant à l’action de cette aliénation. Cela permet d’élargir l’horizon du spectateur qui se trouve ainsi désenvoûté. D’autre part, au fil de l’exposition se tisse une véritable politique attentionnelle. Celle-ci entreprend d’émanciper le spectateur grâce à un accrochage propice à l’attention flottante, tout en élaborant un espace convivial facilitant la démarche du spectateur. A cet état de veille fait écho une politique du care. Enfin, en adoptant une position éminemment réflexive, l’exposition exhorte le spectateur à se plonger dans un état d’attention introspective. In fine, « plutôt que de se demander à quoi nous devrions faire attention, le Crédac nous invite à comprendre ce que nous pourrions faire de notre attention. »[2]
Ambitieuse et dans l’ère du temps, des attentions nous offre ainsi des clés pour résister à la tyrannie attentionnelle, et interroge implicitement les transformations qu’implique l’économie de l’attention dans le milieu de la culture.

Historienne et critique d’art, Hélène Meisel est notamment chargée de recherches et d’exposition au Centre Pompidou-Metz. Catherine Guiral et Brice Domingues enseignent quant à eux le design graphique et participent régulièrement à la mise en œuvre d’expositions. Fondé en 1987 et implanté à la Manufacture de Œillets depuis 2011, le Crédac reçoit le soutien de la Ville d’Ivry-sur-Seine et du Ministère de la Culture et de la Communication – dont il a reçu le label « Centre d’art contemporain d’intérêt national » en septembre 2018.
[1] Citton, Pour une écologie de l’attention, 2014, p. 27.
[2] Idem, p. 247.